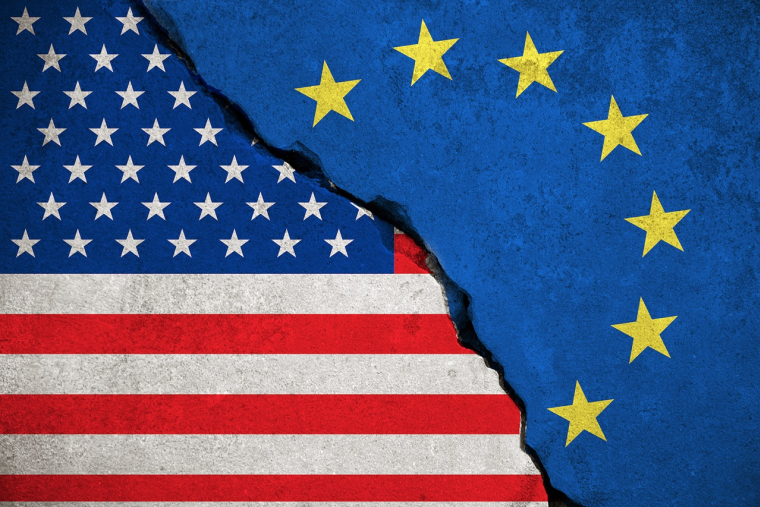
Va-t-il y avoir une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Union européenne ? (Crédits: Adobe Stock)
Si Donald Trump décide de mettre à exécution ses nombreuses promesses de campagne, l'UE verra se présenter à elle plusieurs options : la vassalisation pure et simple ; la confrontation ouverte ; la fragmentation entre alliés et adversaires de la nouvelle administration américaine ; ou encore, et c'est probablement la voie la plus souhaitable, une attitude flexible qui verrait les États membres profiter de cette nouvelle donne pour renforcer l'unité de l'Union sans pour autant trancher l'indispensable lien transatlantique.
À l'orée du second mandat de Donald Trump, trois de ses objectifs déclarés annoncent déjà de possibles contentieux transatlantiques : la volonté de forcer la paix en Ukraine, au risque de capituler face à Poutine ; la volonté de faire payer les Européens pour les garanties de sécurité apportées par les États-Unis à travers l'OTAN ; et la volonté de rééquilibrer le déficit américain à l'égard de l'UE (150 milliards de $) par des mesures protectionnistes.
Il ne faut pas préjuger trop vite des mesures que décidera la nouvelle administration. Après tout, durant son premier mandat, Trump a, certes, été un facteur de désordre mais, contrairement aux craintes qu'avait alors suscitées son accession à la Maison Blanche il n'a pas fait de concessions problématiques à la Russie, pas plus qu'il n'a affaibli l'engagement américain dans l'OTAN ni engagé de guerre commerciale à grande échelle avec l'UE (alors qu'il a forcé une renégociation de l'ALENA – avec le Canada et le Mexique – et un accord commercial avec Pékin). Ses promesses électorales n'impliquent pas nécessairement des actions résolues dès son retour à la Maison Blanche : avant de les appliquer, ou non, Trump et son entourage les passeront sans doute au crible d'une analyse approfondie des risques et des avantages que leur mise en œuvre apporterait aux États-Unis.
Tout cela peut expliquer la prudence des dirigeants européens lors de la réunion du Conseil européen à Budapest tenue le 8 novembre, trois jours après la présidentielle américaine. Il reste que la perspective de voir Washington conduire au cours des quatre prochaines années une politique potentiellement hostile envers l'UE oblige celle-ci à ne pas rester passive. Comment les Européens réagiront-ils face à Trump II ? À ce stade, quatre scénarios peuvent être envisagés.
La fragmentation
Ce n'est sans doute pas le scénario le plus probable à court terme, mais on ne peut écarter l'éventualité que la « trumpisation » des esprits se répande et contribue à pourrir l'Europe de l'intérieur. Celle-ci connaît déjà une forte poussée populiste, nationaliste et « illibérale » sur sa droite, dont Viktor Orban apparaît comme le porte-étendard depuis 2010, et qui s'exprime notamment par l'existence aujourd'hui, au sein de l'UE, de plusieurs gouvernements au sein desquels la droite classique est coalisée avec la droite populiste (Italie, Suède, Finlande, Pays-Bas, Slovaquie, le PiS ayant perdu le pouvoir en Pologne en 2023). Les partis relevant de cette dernière mouvance politique progressent aussi en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche ou encore au Portugal et en Roumanie, liste non exhaustive.
Le camp pro-européen au Parlement européen s'en trouve menacé : il s'est rétréci aux élections de 2024, et s'il perdait sa majorité absolue (encore confortable) face aux extrêmes de droite et de gauche, l'UE pourrait devenir à terme ingouvernable ou mal gouvernable, comme le sont déjà certains pays.
Les partis de droite et d'extrême droite pourraient certes se coaliser sur un programme de protection (contre l'immigration et aussi sur le plan économique), mais il est aussi possible que les divergences nationales s'approfondissent (le Brexit en a été une manifestation). Les positions de l'administration Trump pourraient aussi attiser les différends entre des pays d'Europe divisés sur la manière d'y répondre.
En tout état de cause, il ne faut pas sous-estimer ce que la montée du nationalisme peut avoir de déstabilisant pour la construction européenne.
Le sursaut
On peut espérer que les Européens ont trop conscience de leurs intérêts communs pour se laisser balkaniser. N'ont-ils pas réussi à surmonter toutes les grandes crises depuis une quinzaine d'années (la crise économique globale de 2008, la crise de la zone euro, la crise migratoire, le Brexit, le premier mandat Trump, la pandémie de Covid, les tensions avec la Chine, la guerre en Ukraine) en préservant et en consolidant leur unité ? Le rapport Draghi vient d'appeler à un sursaut afin de sauver la compétitivité de l'économie européenne, même s'il existe des divergences entre États membres sur sa mise en œuvre et notamment son financement (tous ne soutiennent pas la proposition de créer de nouveaux emprunts européens communs).
Dans l'hypothèse la plus favorable, on pourrait imaginer que les Européens décident de prendre entièrement à leur charge le soutien à l'Ukraine (ils en assurent déjà la plus grande partie), que l'UE avance vers l'autonomisation de sa défense par rapport à l'OTAN (soit par un pilier européen plus solide au sein de l'OTAN, soit par une défense européenne propre), et qu'elle défende ses intérêts commerciaux avec résolution. Le mandat Trump se transformerait alors en opportunité de renforcer la souveraineté de l'Europe et son autonomie stratégique, comme Emmanuel Macron l'y invite depuis 2017, et d'en faire un acteur autonome d'un monde multipolaire.
Ce scénario n'est pas le plus probable, car il sous-estime d'une part la force du lien transatlantique, qui repose – malgré l'élection de Trump – sur des valeurs partagées, et d'autre part les divisions entre pays européens. Pratiquement aucun État membre n'est prêt à prendre le risque de s'affranchir de la protection américaine pour la remplacer par une alliance européenne.
La question du parapluie nucléaire, en particulier, est capitale. Poutine en a joué ostensiblement pour faire la guerre à l'Ukraine en se mettant à l'abri de représailles. Il faudrait que les Européens acceptent de se placer sous la protection de la dissuasion nucléaire française (voire britannique) mais une telle évolution ne va pas de soi, même en France. Ajoutons que les États-Unis n'ont pas intérêt à encourager cette option, car l'Alliance atlantique constitue pour eux un instrument essentiel d'influence politique, économique et stratégique, y compris face à leur principale menace, qui est la Chine.
La vassalisation
La vassalisation pourrait être un scénario envisageable si les Européens, tétanisés par la crainte d'un retrait américain, décidaient de satisfaire toutes les conditions fixées par Washington : payer davantage pour l'Ukraine, et/ou accepter un mauvais compromis de paix ; payer davantage pour l'OTAN et acheter davantage de matériel de défense américain ; accepter des concessions commerciales pour rééquilibrer les échanges (par exemple en achetant davantage de GNL) ; renoncer à réguler les géants numériques américains.
Les États-Unis exercent un ascendant sur l'Europe de l'Ouest depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, et sur l'ensemble du continent depuis les années 1990. Les Européens ont parfois contesté la politique de Washington avec succès (on peut penser à la stratégie gaullienne d'indépendance, à la réponse aux sanctions américaines sur le gazoduc euro-sibérien au début des années 1980, aux bras de fer commerciaux, aux amendes infligées aux géants américains), mais en général ils ne sont pas prêts à s'unir contre les États-Unis, comme l'ont montré leurs divisions face à la guerre en Irak en 2003.
Ils n'ont pu régler les conflits de l'ex-Yougoslavie (Bosnie, Kosovo, Macédoine) qu'avec l'intervention américaine. Ils ont suivi Washington en Afghanistan. Le durcissement progressif face à la Russie et à la Chine s'est aussi largement décidé avec les encouragements, sinon les pressions, de Washington (par exemple, le bannissement de l'opérateur chinois Huawei des réseaux 5G, survenu durant le premier mandat Trump). Inversement, les Européens n'ont pas cherché à contrebalancer le soutien américain à Israël après 2000, qui a fini par tuer toute perspective de règlement politique avec les Palestiniens.
Cette tendance, qui est aussi le résultat des divisions européennes, pourrait s'accentuer malgré l'isolationnisme de Trump. Celui-ci n'a d'ailleurs pas menacé d'un retrait de l'OTAN : il a seulement demandé aux Européens de contribuer davantage. L'allié américain pourrait ainsi se faire moins commode et plus exigeant, et les pays européens plus dociles et chétifs. Le fait est qu'aujourd'hui les États-Unis exercent une supériorité beaucoup plus forte que dans le passé, à la fois sur le plan économique (un PIB supérieur de 50 % à celui de l'UE, pour une population pourtant inférieure) et sur le plan militaire (des dépenses militaires trois fois plus importantes), et que les entreprises européennes sont plus exposées que leurs homologues américaines.
La vassalisation offre le confort de l'obéissance et de la protection, mais elle peut être contestée par les opinions publiques si elle cesse d'être feutrée (le « soft power ») pour devenir explicite et brutale.
La stratégie du dos rond
Les scénarios limites peu probables (la fragmentation, le sursaut) ou non souhaitables (la soumission) dessinent aussi un scénario médian réaliste, dans lequel les Européens feraient preuve de prudence et de souplesse, en protégeant leurs intérêts tout en évitant d'antagoniser la nouvelle administration américaine, pour préserver l'Alliance atlantique et préparer des jours meilleurs. C'est déjà ce qui s'était passé durant le premier mandat Trump.
La meilleure stratégie européenne dans ce cas est d'adopter une posture réactive, d'attendre et voir (wait and see), de délier les dossiers, en évitant l'épreuve de force globale (sauf si Washington décidait de l'engager, mais il serait logique que l'épreuve de force soit d'abord lancée vis-à-vis des rivaux stratégiques que sont la Chine et la Russie).
Sur l'Ukraine, il faudra attendre les arbitrages de la nouvelle administration, tenter de les influencer, négocier le moment venu, et veiller à ce qu'un « deal » éventuel avec Poutine (qui n'est nullement certain) préserve au maximum les intérêts de sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. Ce sera sans doute aux principales capitales (Berlin, Paris, mais aussi Londres, et peut-être d'autres) d'accorder leurs violons pour peser face à Washington.
Sur l'OTAN, l'échéance importante sera le sommet de La Haye en juin 2025. Il faut que les Européens soient à même de répondre à la nouvelle administration, de consolider un pilier européen dans l'OTAN en contribuant davantage en dépenses militaires et en troupes, mais aussi en crédibilisant une option européenne pour la défense du continent.
Sur le commerce, il faudra là aussi attendre les décisions de la nouvelle administration : guerre commerciale ? Nouveaux tarifs ? L'UE n'est pas dépourvue d'armes, maniées par la Commission européenne, car la politique commerciale commune constitue un redoutable atout de puissance pour les Européens. Il faudra entrer dans une logique de dissuasion/réaction car les États-Unis ont aussi à perdre d'une confrontation commerciale.
Les relations internationales procèdent d'un jeu constant d'actions/réactions. Il est inévitable que Washington, en raison du poids des États-Unis et du caractère transgressif et imprévisible des positions du nouveau président américain, soit à l'offensive, alors que les pays européens sont divisés. Ces derniers doivent se préparer avec prudence et intelligence, en gardant leur sang-froid, en préservant leur unité, et en mettant de leur côté l'habileté et le sens de l'opportunité. Le pire n'est pas sûr et l'élection de Trump offre aussi une occasion de renforcer l'autonomie et la résilience européennes.
Par Maxime Lefebvre
Permanent Affiliate Professor, ESCP Business School
Cet article est issu du site The Conversation




1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer