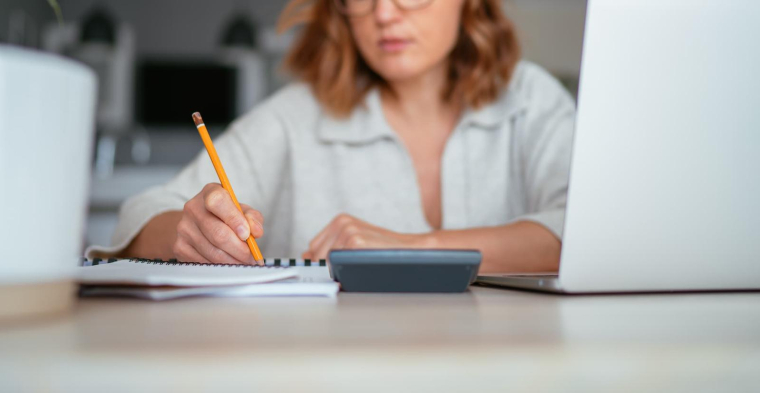
Shutterstock
Les femmes sont nombreuses à épargner avec régularité, mais restent en retrait de l’investissement. Un paradoxe aux effets durables sur leur sécurité financière.
Les femmes mettent de l’argent de côté avec constance, parfois même avec plus de rigueur que les hommes, mais franchissent rarement le pas de l’investissement. Ce réflexe façonne pourtant leur avenir financier : moins d’actions, moins de placements diversifiés et, à terme, un patrimoine qui croît plus lentement. Derrière cette prudence souvent jugée rassurante, se cache un coût invisible. Cette retenue se traduit par une sécurité financière plus fragile, notamment au moment de la retraite, là où les écarts de patrimoine deviennent les plus criants.
La confiance en soi comme barrière invisible
Selon le baromètre de l’AMF, huit femmes sur dix épargnent chaque mois ou de façon occasionnelle, soit autant que les hommes. Mais les montants restent moindres : 210 euros en moyenne contre 280 euros pour leurs homologues masculins. Lorsqu’il s’agit d’investir, le fossé se creuse davantage : en 2022, les femmes ne représentaient que 30 % des investisseurs actifs (au moins une opération boursière dans l’année). Cet écart reflète à la fois des revenus plus faibles, puisque l’Insee rappelle qu’en 2021 le salaire moyen des femmes dans le secteur privé était inférieur de 24 % à celui des hommes, et une approche plus prudente face au risque.
La confiance apparaît comme un frein central. Toujours selon l’AMF, à peine 29 % des femmes estiment s’y connaître en matière de placements, contre 42 % des hommes. Pourtant, lorsque leurs connaissances sont testées, les écarts sont minimes. Elles se sous-estiment, là où les hommes ont tendance à se surestimer. Résultat : avant de se lancer, beaucoup de femmes attendent le moment parfait ou multiplient les conseils auprès d’experts et de proches. Comme l’explique Morgane Dion, cofondatrice de l’application Plan Cash, dans Ouest-France , « les femmes, comme dans tout secteur, ont l’impression qu’elles ont besoin de tout savoir avant de se lancer. Elles vont reporter le premier investissement alors que les hommes attendent moins le moment parfait ».
Une aversion au risque renforcée
Cette hésitation se traduit aussi par une aversion marquée au risque. Près de 48 % des femmes refusent les placements jugés dangereux, contre 36 % des hommes, d’après l’AMF. Pour beaucoup, la Bourse reste associée à un univers incertain, voire à un « casino » : en Belgique, 42 % des femmes partagent ce sentiment, contre 27 % des hommes, selon une étude ING. Résultat : elles privilégient les comptes d’épargne classiques, malgré des rendements laminés par l’inflation. « Dans un monde où l’inflation va demeurer plus élevée que par le passé, laisser ses économies « dormir » dans une solution d’épargne, sur un compte courant ou en cash engendre un appauvrissement. Par conséquent, étant donné que les femmes sont moins enclines à investir, elles sont toujours plus susceptibles d’avoir connu un appauvrissement dû à l’inflation au cours des dernières années. Cela conduit à un écart en termes de patrimoine entre hommes et femmes qui demeure et qui risque de s’accroître au fil du temps », indique Charlotte de Montpellier, économiste senior chez ING, dans l’étude publiée en juillet 2025.
Et pourtant, lorsqu’elles investissent, les femmes obtiennent souvent de meilleurs résultats. L’Université de Warwick a montré que leurs portefeuilles affichaient en moyenne 1,8 % de performance de plus que ceux des hommes sur trois ans. Fidelity Investments ou encore l’Université de Californie confirment cette tendance, même si l’écart est parfois plus faible. En cause ? Une approche plus réfléchie, moins d’opérations impulsives et une vision de long terme. « Les femmes tradent moins, privilégient la diversification et gardent des objectifs clairs », souligne Matthias Baccino, directeur des marchés européens chez Trade Republic, dans Les Échos .
Le poids de la culture et des stéréotypes
Ces comportements ne relèvent pas uniquement de choix individuels, mais s’inscrivent dans une socialisation différenciée. De nombreux travaux montrent que les garçons sont plus souvent encouragés à la prise de risque, par le sport notamment, tandis que les filles sont socialisées à la prudence, ce qui finit par peser sur leur confiance financière. À l’âge adulte, cette construction se traduit par une tendance à sous-estimer leurs compétences et par une méfiance vis-à-vis des placements. Et l’histoire récente rappelle que ces freins ne sont pas anodins : jusqu’à la loi de 1965, les femmes mariées ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire ni gérer librement leurs biens sans l’autorisation de leur mari.
Pour réduire ces écarts, l’éducation financière joue un rôle décisif. Ces dernières années, des programmes spécifiques ont vu le jour, comme les formations de Plan Cash ou les initiatives soutenues par la Carac, qui proposent des parcours adaptés aux débutantes. L’idée n’est pas seulement de rattraper un retard, mais de donner aux femmes les clés pour construire leur indépendance financière. Un autre levier réside dans la création d’espaces d’échanges où les femmes peuvent parler d’argent sans tabou, partager leurs expériences et s’encourager mutuellement.
Aux États-Unis, le mouvement du financial feminism a ouvert la voie, mais la tendance gagne aussi la France, avec l’émergence de collectifs ou de clubs d’investissement féminins. C’est le cas de Femmes Business Angels, premier réseau de business angels féminins en France et en Europe, qui réunit plus de 170 investisseuses finançant des startups et accompagnant leurs fondatrices. Certaines plateformes développent même des parcours pédagogiques gamifiés ou des simulateurs accessibles pour tester des scénarios sans risque. Ces outils permettent de lever la peur, de gagner en confiance et de transformer une simple épargne en véritable levier de liberté financière.




0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer