
L’éducation financière peut être un facteur de lutte contre les inégalités. (Crédits: Adobe Stock)
Très tôt, à l'école, on apprend à compter et à maîtriser des concepts mathématiques parfois complexes. Est-on pour autant capable, dans la pratique, de comprendre des notions élémentaires en finance ou de s'orienter dans l'offre bancaire ? La mise en place d'une éducation spécifique à ces questions n'est-elle pas un enjeu d'égalité ?
Selon la Banque de France, 41 % des Français estiment ne pas disposer d'informations suffisamment fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget, 69 % jugent leurs connaissances moyennes ou faibles sur les questions financières et 80 % considèrent qu'une éducation financière est nécessaire à l'école.
Depuis 2016, à l'instar de 70 autres pays, la France s'est dotée d'une stratégie nationale d'éducation économique, budgétaire et financière (Educfi). Concrètement, chaque année, une semaine de sensibilisation est organisée à l'échelle internationale par l'OCDE, et la Banque de France en est le relais français.
Dans les collèges, le passeport Educfi s'adresse aux élèves de quatrième, SEGPA, troisième, prépa-métiers et voie professionnelle. Mais face aux défis de notre société, ces dispositifs sont-ils suffisants ?
Qu'est-ce que l'éducation financière ?
L'éducation financière, (également appelée littératie financière), consiste à savoir gérer son budget, comprendre ce qu'implique un crédit, adopter les bons réflexes contre les arnaques, maîtriser la sécurité de ses moyens de paiement, optimiser son épargne et ses investissements et, cela, tout au long de sa vie.
Ces compétences sont un vecteur d'émancipation citoyenne et d'autonomie, elles permettent aux jeunes de mieux anticiper les aléas de la vie (chômage, dettes, imprévus). Le manque d'éducation financière est identifié comme un facteur de vulnérabilité face au crédit facile, au découvert bancaire ou aux arnaques numériques.
En 2023, sur la base des connaissances financières, de la relation à l'argent et du comportement face aux situations pratiques, la culture des Français de plus de 18 ans était estimée à 12,45/20 par une enquête de l'institut CSA. 64 % des 15-17 ans se déclarent intéressés pour mieux comprendre ce qu'est un placement, une assurance, un crédit, un moyen de paiement.
Avec 17% de la population estimant disposer d'un niveau de culture financière élevé, la France se situe légèrement en dessous de la moyenne européenne (18 %) et loin des Pays-Bas (28 %). Au niveau mondial, la France se situe également dans la moyenne.
Les Scandinaves ont la meilleure culture financière, suivis par les pays anglo-saxons. Dans les écoles suédoises et norvégiennes, la finance est intégrée dans les cours de mathématiques et de sciences sociales où les écoliers apprennent à gérer un budget, à comparer des crédits, à consommer de façon responsable. La littératie financière fait partie intégrante des programmes nationaux.
Finalement, les jeunes ayant reçu une éducation financière sont significativement moins susceptibles d'accumuler des dettes à la consommation à l'entrée dans la vie adulte. En outre, l'éducation financière développe l'esprit critique : savoir comparer une offre de prêt, comprendre les frais cachés, ou mesurer les conséquences d'un investissement.
Une exigence sociale face aux inégalités
L'école a pour mission de former des citoyens libres et éclairés en mobilisant toutes les disciplines. Elle peut ainsi permettre de comprendre les principes de l'impôt, du budget de l'État ou des régimes sociaux. Une culture économique de base permet de garantir la participation démocratique à des décisions budgétaires locales et nationales. En outre, la montée en puissance des fintechs, des cryptomonnaies, et des paiements dématérialisés appelle une mise à jour des compétences scolaires.
L'éducation financière peut être un facteur de lutte contre les inégalités. En effet, de nombreuses irrationalités dans le comportement des épargnants peuvent s'expliquer par le manque d'éducation financière. Par exemple, les enfants issus de milieux modestes sont les plus exposés à une méconnaissance des outils financiers.
L'école peut jouer un rôle compensateur et une généralisation de l'éducation financière permettrait de rompre ce cycle de transmission de méconnaissance économique. 71 % des personnes dont les parents avaient des difficultés financières durant leur adolescence déclarent quand ils sont adultes être toujours en difficulté financière, contre 51 % de celles dont les parents étaient financièrement à l'aise.
Bien que le surendettement concerne moins de personnes aujourd'hui (42 % de baisse depuis 2014), les plus vulnérables (femmes, familles monoparentales, et personnes à bas revenus) sont plus durement touchés. Les ménages mieux formés économiquement amortissent mieux les chocs de crise, comme l'a montré la pandémie de Covid-19. La résilience financière (c'est-à-dire la capacité à trouver, dans un délai d'un mois, une somme d'argent correspondant à 5 % du revenu national brut) est de 79 % des adultes dans les pays à hauts revenus. Une plus grande littératie financière améliore cette résilience des ménages, mesurée avec des variations de liquidité avant/après un choc macroéconomique.
Une éducation difficile à mettre en place ?
Au sein des pays de l'OCDE, la France est souvent présentée comme en retard dans l'intégration de l'éducation financière à l'école. Cela peut s'expliquer par des programmes déjà très chargés qui ne laissent pas de place à de nouvelles matières. L'éducation financière est également souvent jugée comme secondaire par rapport aux fondamentaux (mathématiques, français, sciences) et certains enseignants craignent une « financiarisation » de l'école. Cependant, certains experts plaident pour une matière dédiée, quand d'autres estiment que l'éducation financière peut être intégrée à des disciplines existantes (mathématiques, économie, EMC).
Se pose également la question des acteurs légitimes, autrement dit : qui doit enseigner l'éducation financière ? Les enseignants, déjà très sollicités, manquent de formation spécifique et se sentent peu légitimes pour aborder des notions financières. En outre, l'intervention d'organismes financiers privés soulève des soupçons de conflits d'intérêt.
Quelle que soit la solution retenue, la formation initiale et continue des enseignants reste essentielle ainsi que le recours à la diversité des outils numériques. Finalement, les programmes délivrés par des acteurs indépendants, non commerciaux, obtiennent une meilleure adhésion des enseignants et des familles.
Éric Le Fur
Professeur, INSEEC Grande École
Cet article est issu du site The Conversation

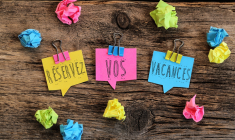


4 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer