
Le club SchwuZ, le plus ancien et le plus grand club queer d'Allemagne, lors d'une soirée, le 11 octobre, 2025 à Berlin ( AFP / Pierrick YVON )
Capitale de la fête depuis la chute du Mur, Berlin voit des clubs célèbres fermer depuis la pandémie, victimes de l'inflation et de la pression immobilière. Entre résistance et adaptation, la lutte pour la survie s'organise.
Un dimanche soir de fin d'été. La soirée bat son plein pour les 18 ans du Renate, club aménagé dans un immeuble d'habitation en bord de la rivière Spree. Les clients se pressent dans le labyrinthe de couloirs qui relient les pièces tamisées, animées chacune par un DJ set différent.
Mais cet anniversaire doit être le dernier, car Renate doit fermer ses portes à la fin de l'année, à l'expiration du bail.
Venu du Royaume-Uni, Oscar Lister, 30 ans, dit à l'AFP être "vraiment triste" de venir ici "probablement pour la dernière fois".
"Tous les clubs berlinois que je connaissais à l'époque où j'ai grandi ferment en ce moment", regrette Maike Schöneberg, une Berlinoise de 33 ans.
Griessmühle, Mensch Meier, Remise, Watergate... Le phénomène du "Clubsterben", "la mort des clubs", a épinglé depuis 2023 quelques unes des célèbres enseignes de la capitale allemande.
A la pression immobilière, qui a accéléré la gentrification d'une capitale autrefois bon marché, s'ajoutent la hausse des coûts et la baisse des visiteurs.
Levier souvent activé pour compenser, l'explosion des prix d'entrée - décorrélée de l'inflation, soulignent certains - et des consommations a achevé le cercle vicieux. "Pour bon nombre d'amis, cela devient maintenant un peu trop cher", constate auprès de l'AFP Milos, un ingénieur de 43 ans.
- A louer ! -

Une banderole s'adressant aux voisins du club "Renate" au sujet de sa fermeture annoncée, le 14 Septembre 2025 à Berlin. ( AFP / John MACDOUGALL )
Fin 2024, la Clubcommission, l'association des boîtes de nuit berlinoises, tirait la sonnette d'alarme en affirmant que 46% de ses membres envisageaient de fermer dans les 12 prochains mois.
Et 61% d'entre-eux indiquaient avoir enregistré récemment une baisse "considérable" de leurs revenus.
C'est le cas du SchwuZ, "plus ancien et plus grand club queer d'Allemagne" voire "d'Europe", selon sa directrice générale Katja Jäger.
"A partir de 2024, une baisse du chiffre d'affaires s'est clairement fait sentir", entraînant un déficit mensuel moyen "d'environ 50.000 euros", explique-t-elle à l'AFP.
La baisse du pouvoir d'achat de la clientèle est criante: "Les gens ne boivent plus trois ou quatre consommations, mais peut-être seulement une".
Fin juillet, le SchwuZ a donc déclaré faillite et appelé la communauté LGBT+ à "revenir faire la fête" pour le sauver d'une fermeture.
En plus d'un sursaut espéré de son public cible, l'institution semi-séculaire, basée sur un fonctionnement associatif, a également lancé fin septembre un appel aux dons, récoltant jusqu'ici environ 50.000 euros.
Et on peut désormais "louer le SchwuZ", souligne Kata Jäger, qui cherche à rentabiliser ses 1.600 m2 en diversifiant les activités: soirées pour jeunes, gothique, sans alcool ou de jour, comédie musicale, fêtes d'entreprise ou privées...
Dans cette ambiance morose, la Clubcommission tente de redonner de l'élan au secteur avec un festival qui s'est achevé dimanche.
Open airs, performances, expositions, projections, ateliers y construisent des passerelles entre musiques urbaines et d'autres formes d'art, et des bourses sont remises à certains clubs pour leurs initiatives.
Parmi eux, Maaya, avec la culture afro comme socle, se revendique un espace mixte de culture, avec piscine et restauration.
Ouvert l'an dernier, l'endroit "marche à fond", affirme à l'AFP Aziz Sarr, l'un des fondateurs.
- "Exclusivité" -
"Le milieu des clubs berlinois ne se porte pas que mal: de nouveaux projets émergent, de nouveaux lieux ouvrent, même s'ils sont peu nombreux", dit à l'AFP Katharin Ahrend, directrice générale de la commission.
Ces "nouveaux formats" sont "beaucoup plus orientés vers les communautés, comme des collectifs queer, des gens de couleur, des sober raves", souligne Emiko Gejic, porte-parole de la commission.

La rive droite de la Spree à Berlin, le 14 septembre 2025, est l'épicentre des clubs nés après la chute du mur et dont la survie est pour beaucoup menacée ( AFP / John MACDOUGALL )
"Berlin est une ville qui va toujours se réinventer", assure Anne, 32 ans, une Berlinoise qui apprécie autant les "petits endroits" que les raves et ne voit pas d'un mauvais oeil la fin de "l'hégémonie des grands".
Chez ces derniers, les plus à mêmes de survivre sont ceux qui "ont une identité propre et un label particulier", ajoute Emiko Gejic.
Comme le Berghain, à la réputation forgée par sa hauteur sous plafond, et une programmation aussi exigeante que la sélection de la clientèle à la porte.
A l'inverse du Watergate qui pouvait compter dans son public jusqu'à 70% de touristes, le Berghain "a fait le choix stratégique de l'exclusivité", soulignent les universitaires Guillaume Robin et Patrick Farges dans l'ouvrage "Les industries culturelles et créatives".


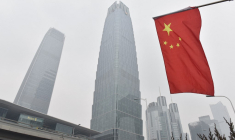


0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer