
Aider son enfant à acheter son logement n’est pas seulement un acte de solidarité ponctuel. C’est aussi une manière d’anticiper la transmission de son patrimoine. ( crédit photo : Getty Images )
Sommaire:
- Le rêve d’un premier toit, face aux réalités du marché immobilier
-
Auriane souhaite mobiliser 50.000 euros pour aider son fils à décrocher un crédit -
La donation: simplicité et fiscalité avantageuse - Le prêt familial: une solution a priori séduisante mais à prendre avec précaution
-
La SCI: une solution plus patrimoniale - Un choix à calibrer selon son patrimoine et ses envies
Le rêve d’un premier toit, face aux réalités du marché immobilier
Auriane, ex-ingénieure en aéronautique, a pris sa retraite de façon anticipée. Elle observe depuis plusieurs mois l’inquiétude de son fils Thomas: il souhaite acquérir son premier bien immobilier. Comme beaucoup de jeunes actifs, il a beau gagner correctement sa vie -environ 2600 euros nets par mois-, son dossier de crédit bloque. Deux raisons expliquent ce fait:
- Depuis 2022, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) impose aux banques de ne pas accorder de crédit immobilier si le taux d’endettement (assurance incluse) dépasse 35% des revenus d’un ménage,
- Dans le même temps, la hausse brutale des taux d’intérêt a bouleversé les capacités d’achat: en deux ans, les taux moyens sont passés d’environ 1% (début 2021) à plus de 4% (fin 2023). En 2025, ils sont stabilisés autour de 3%, .
Concrètement, un emprunteur qui pouvait financer 250.000 euros en 2021, avec une mensualité de 1000 euros ne peut plus lever aujourd’hui que 210.000 euros. C’est 40.000 euros de moins, soit une chute de capacité d’achat de plus de 15%. Pourtant, les prix immobiliers -même s’ils ont récemment commencé à se stabiliser- sont loin d’avoir reculé d’autant… Cet écart doit donc désormais être comblé par un apport personnel plus conséquent. Or, Thomas n’en a pas pour le moment.
A noter
Un apport personnel solide devient presque indispensable pour décrocher un crédit aujourd’hui, surtout pour les primo-accédants. Même si techniquement certains établissements accordent du financement à 100%, les banques militent souvent pour un apport personnel équivalent au minimum à 10% du montant total.
Auriane souhaite mobiliser 50.000 euros pour aider son fils à décrocher un crédit
Auriane est affligée par cette situation de blocage. Elle s’en souvient bien: il y a trente ans, les jeunes actifs n’avaient pas besoin des parents pour acheter un logement. Certes, les taux étaient très élevés dans les années 1990 (8 voire 9 ou 10%), mais le dynamisme économique et financier permettait d’emprunter sans apport.
Elle décide d’aider son fils en mobilisant 50.000 euros de son épargne personnelle. Le but est de sécuriser son dossier auprès des banques. Thomas recherche un deux-pièces de 45 à 55 m² à Lyon, où il réside depuis ses études, pour environ 250.000 euros. L’apport financier d’Auriane est solide car il représente 20% du montant du crédit recherché.
L’idée est généreuse mais concrètement… Comment procéder? Auriane se penche sur les solutions, avec l’objectif de soutenir son fils sans fragiliser sa propre situation financière.
La donation: simplicité et fiscalité avantageuse
La première option est la plus directe: la donation simple. Chaque parent peut donner jusqu’à 100.000 euros tous les quinze ans à chacun de ses enfants, sans payer de droits de donation. Dans le cas d’Auriane, ses 50.000 euros seraient donc totalement exonérés. L’avantage? Rapidité et clarté. La donation permet en effet de matérialiser un vrai transfert de patrimoine. Cela rassure la banque: elle considère l’apport comme acquis.
Deux façons de procéder existent:
- La donation manuelle : il s’agit simplement d’un virement bancaire ou d’un chèque, devant être déclaré à l’administration fiscale via le formulaire n°2735. Cette déclaration permet de déclencher l’abattement et d’éviter tout litige ultérieur au moment de la succession.
- La donation notariée : elle passe par un acte officiel, signé devant notaire. Il sécurise la transaction et laisse une trace juridique incontestable. Cette option est particulièrement recommandée lorsque les montants en jeu sont importants ou lorsqu’il y a plusieurs enfants, pour éviter les tensions futures.
Si Auriane choisissait la donation, elle choisirait la donation notariée, car elle a un autre fils de 14 ans et souhaite l’aider à son tour quand il en aura besoin. Pour rappel, le droit prévoit que toutes les donations sont rapportables à la succession, sauf mention contraire. Autrement dit, au moment du partage, les 50.000 euros donnés à Thomas seront pris en compte, garantissant l’égalité avec son frère.
A savoir
Attention: une donation est irrévocable. Une fois l’argent donné, Auriane ne peut plus le récupérer. Elle doit donc veiller à préserver sa propre sécurité financière, notamment pour sa retraite.
Le prêt familial: une solution a priori séduisante mais à prendre avec précaution
Autre option pour Auriane: transformer son aide en prêt familial. Le principe est simple: elle prête les 50.000 euros à son fils. Lui s’engage à les lui rembourser selon des modalités fixées à l’avance. Cette solution présente un avantage majeur pour la mère: elle conserve la possibilité de récupérer son argent à terme. Pour être valable, le prêt doit être formalisé par écrit dès lors qu’il dépasse 1500 euros. Le plus souvent, il s’agit d’un contrat rédigé sous seing privé, signé entre les deux parties, précisant:
- Le montant prêté,
- La durée de remboursement,
- Le calendrier des échéances,
- Éventuellement: le taux d’intérêt appliqué (pouvant être nul, mais devant rester cohérent pour éviter d’être requalifié en donation déguisée).
A noter
Tout prêt supérieur à 5000 euros doit être déclaré à l’administration fiscale via le formulaire n°2062. Cette formalité évite tout risque de redressement ultérieur et protège à la fois le parent et l’enfant.
Cette solution est séduisante sur le papier, mais peut constituer un revers pour Thomas: si Auriane lui prête 50.000 euros sur 10 ans, cela représente des mensualités d’environ 420 euros par mois à rembourser, en imaginant un prêt à taux zéro. Thomas doit, en plus, assumer ses mensualités bancaires immobilières de 1160 euros par mois en cas de crédit de 210.000 euros sur 20 ans à 3%. Cela rend la situation impossible: le HCSF plafonne son endettement à environ 910 euros (35% de 2600 euros nets par mois).
Auriane peut malgré tout envisager le prêt familial, en faisant en sorte qu’il soit sans échéance immédiate (par exemple, un remboursement différé peut être prévu au moment de la revente du bien), ou que les mensualités soient adaptées à la capacité réelle de remboursement de son fils. Cependant, dans la majorité des cas, les notaires conseillent plutôt la donation. Elle a l’avantage de clarifier la situation pour tout le monde, en particulier vis-à-vis de la banque. Le prêt familial peut en effet être source de tensions dans une famille pour plusieurs raisons:
- Une perte d’emploi ou une séparation peut rendre le remboursement difficile,
- Le risque de retards de remboursements de la part d’un enfant à un parent reste possible,
- Cela peut générer un sentiment d’injustice par rapport aux autres membres de la fratrie…
La SCI: une solution plus patrimoniale
Une troisième option pour Auriane consiste à créer avec son fils une Société Civile Immobilière (SCI) . Le principe est simple: chacun apporte du capital - 50.000 euros pour elle, une somme moindre pour lui - et la société achète le bien en leur nom. Les deux deviennent alors associés, non pas directement propriétaires du logement, mais détenteurs de parts sociales correspondant à la valeur de leur apport. Cette structure offre une grande souplesse: il est possible de transmettre progressivement des parts au fil du temps, en profitant des abattements fiscaux. Cela contribue à préparer la succession de manière douce et anticipée.
La SCI permet aussi d’élargir le projet familial: rien n’empêche d’y intégrer, à terme, d’autres enfants ou membres de la famille. Les statuts peuvent organiser l’usage futur du logement. Ils décident par exemple qu’il sera mis en location, ou mis à disposition d’un frère ou d’une sœur. Cette flexibilité en fait un outil privilégié pour éviter les blocages de l’indivision et donner une vision de long terme au patrimoine.
Toutefois, la création d’une SCI entraîne quelques frais (1000 euros en moyenne) et suppose une certaine rigueur administrative (comptabilité, tenue d’assemblées…), mais ces contraintes sont compensées par les avantages en matière de transmission (possibilité de donations successives ou de démembrement). Pour une famille qui souhaite à la fois aider un enfant à s’installer et réfléchir à l’avenir patrimonial collectif, la SCI constitue souvent une solution sécurisante.
Un choix à calibrer selon son patrimoine et ses envies
Aider son enfant à acheter son logement n’est pas seulement un acte de solidarité ponctuel. C’est aussi une manière d’anticiper la transmission de son patrimoine. Après réflexion et consultation auprès de son notaire, Auriane, qui dispose de 250.000 euros d’épargne et d’un appartement déjà payé, penche pour la donation plutôt que la SCI, qu’elle trouve trop contraignante d’un point de vue administratif. Elle peut se le permettre sans mettre en péril sa sécurité financière.
De plus, en utilisant une partie de son abattement de 100.000 euros dès aujourd’hui, Auriane réduit d’autant la base taxable de sa succession future. Beaucoup de familles choisissent d’ailleurs cette stratégie de donations échelonnées. Tous les quinze ans, les parents peuvent redonner jusqu’à 100.000 euros en franchise de droits. Sur une génération, cela peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros.


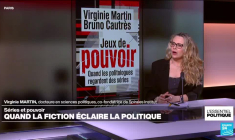

0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer