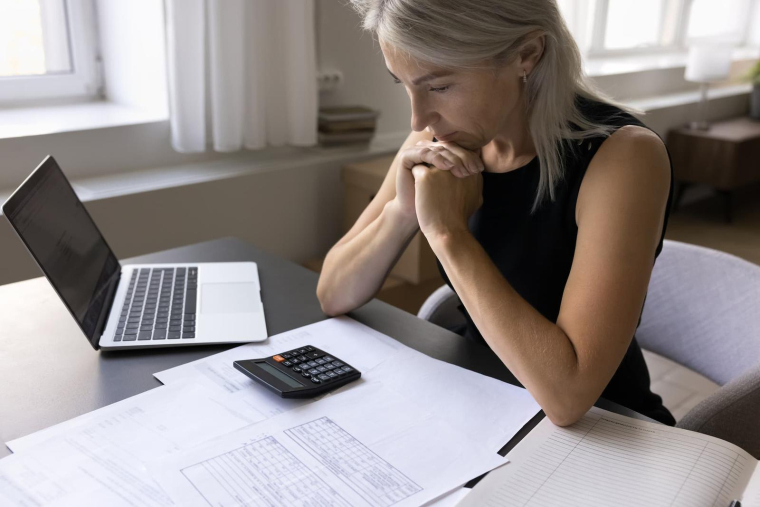
Shutterstock
Sous ses airs neutres, l’impôt sur le revenu cache un biais bien réel : il pénalise encore les femmes, même au sein du couple.
En matière d’égalité, l’impôt sur le revenu a encore bien des progrès à faire. Derrière l’apparente neutralité du barème progressif se cache un système qui, sans le vouloir, désavantage systématiquement les femmes. Selon l’Insee, les écarts de revenus entre les sexes se creusent dès lors que les couples se forment : les femmes mariées ou pacsées gagnent en moyenne 42 % de moins que leur conjoint, contre seulement 9 % d’écart chez les célibataires. Une inégalité de revenus qui, combinée à la “familialisation” de l’impôt, finit par peser lourdement sur les épaules féminines.
Le piège du quotient conjugal
Créé pour simplifier la fiscalité et encourager la vie de couple, le quotient conjugal est devenu un mécanisme inégalitaire. En principe, il permet à un couple marié ou pacsé de déclarer ensemble leurs revenus, ce qui réduit le montant global de l’impôt lorsque leurs salaires sont très différents. Mais derrière cet avantage collectif se cache une distorsion individuelle : le taux d’imposition du conjoint le moins bien rémunéré augmente. “Le revenu des femmes est davantage taxé qu’il ne le serait en l’absence d’imposition commune, ce qui a un effet dissuasif sur le travail féminin et crée de véritables trappes à inactivité” , explique Lise Chatain, maître de conférences à la faculté de droit et de science politique de Montpellier, dans les colonnes des Echos .
L’instauration du prélèvement à la source en 2019 n’a fait qu’exposer davantage le problème. Par défaut, le fisc applique à chaque membre du couple le taux moyen du foyer fiscal. Résultat : celle ou celui qui gagne moins, souvent la femme, voit son revenu net amputé plus fortement qu’il ne le serait avec une imposition séparée. Il existe bien une option pour des taux “individualisés”, calculés selon les revenus de chacun. Mais cette possibilité reste méconnue et suppose, dans les faits, un pouvoir de négociation au sein du couple. “On peut s’interroger sur le choix du législateur qui a posé le principe du taux commun par défaut” , remarque encore Lise Chatain.
Un choix par défaut fondé sur un vieux modèle
Le taux commun repose sur une idée héritée de 1945 : celle d’un couple qui partage intégralement ses ressources. “Faire le choix d’un taux commun par défaut repose sur le postulat que les couples mettent toutes leurs ressources en commun et « que le conjoint le moins bien rémunéré bénéficie d’une redistribution supposée des ressources de son conjoint mieux rémunéré” , observe la chercheuse. Or, d’après l’Insee, seuls 59 % des couples dont les deux conjoints travaillent mettent effectivement tous leurs revenus en commun. Les autres conservent des finances partiellement séparées, preuve que la fiscalité repose sur un modèle familial d’un autre temps.
Consciente du biais, la direction générale des Finances publiques a annoncé un tournant : depuis septembre 2025, le taux individualisé est devenu la règle par défaut. Un changement bienvenu pour de nombreuses femmes. Ainsi, dans un couple dans lequel l’homme perçoit 3 500 euros nets et la femme 1 600 euros, le taux “foyer” de 5,8 % conduisait chacun à payer le même pourcentage. Avec ce nouveau système, le taux grimpe à 8,3 % pour l’homme, tandis que la femme n’est imposée qu’à 0,4 %. Le montant total d’impôt reste identique, mais la répartition, enfin, reflète les revenus réels de chacun.
L’argent, toujours un sujet tabou
Reste une difficulté plus intime : parler d’argent au sein du couple. En France, les discussions autour des revenus et des dépenses restent souvent embarrassées, comme si l’argent heurtait la pudeur. Ce silence nourrit les inégalités : celui ou celle qui gagne le moins hésite à revendiquer une fiscalité individualisée ou une meilleure répartition des dépenses. “Les femmes vont plus fréquemment payer les dépenses du quotidien, alors que les hommes vont davantage investir (…). Des dépenses qui permettent de se construire un capital” , a rappelé la journaliste Lucile Quillet au micro de Franceinfo. À long terme, cette asymétrie contribue à appauvrir les femmes, surtout après une séparation.
La réforme de 2025 n’effacera pas d’un coup les effets de décennies d’inégalités fiscales, mais elle marque une avancée majeure. Elle rompt avec le modèle du foyer unique et reconnaît enfin que chaque contribuable doit être imposé selon ses propres revenus. Pour Marie-Pierre Rixain et Laurence Trastour-Isnart, les deux députées à l’origine du rapport parlementaire sur l’égalité économique, “le respect d’une taxation équitable des membres du couple aurait dû conduire à poser comme règle l’application du taux individualisé, en laissant au couple une possibilité d’option pour le taux commun” . Le message est désormais entendu. Et si la fiscalité n’efface pas encore toutes les inégalités de genre, elle pourrait enfin cesser de les entretenir.




3 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer